Les aveugles peuvent connaître les lignes, mais pas les couleurs.
Le problème du « sens de la vie » n'est pas philosophique mais esthétique : nous avons une vision faussée de l'absurde.
Or seule une image peut s'opposer à une autre image. Ce qu'il nous faut donc, plus qu'une philosophie, c'est une esthétique de l'absurde.
Le mot « absurde » désigne d'abord une attente de sens déçue, donc une tristesse. Mais là où est le danger, là croît aussi ce qui sauve. Le remède à cette déception n'est pas dans la quête du sens, mais dans l'absurde lui-même.
A force de percevoir l'absurde comme une tristesse, nous oublions cette vérité fondamentale : la vie, le désir, le plaisir, le bonheur sont des choses fondamentalement absurdes. Mais vigoureusement absurdes, joyeusement absurdes, comme les rayons du soleil dans un matin d'été.

La difficulté de la vie tient à ce fait : la tristesse est sensée, la joie est absurde. D'où il faut conclure que l'absurde est supérieur au sens.
Voici, en termes athées, la traduction du bon vieux « credo quia absurdum ».
Cf. le goût de l'absurde.
Spontanément, je n'aime pas beaucoup le travail. Mais je dois lui reconnaître cet avantage : la notion de travail donne sens à la vie.
Par la notion de travail, j'entends l'idée qu'on n'est pas, au début, encore soi, l'idée qu'on doit devenir ce que l'on est, se réaliser. L'idée que tu dois devenir ce que tu es, que tu « restes à faire »...
On le voit, ce n'est que de manière accidentelle que le « travail » au sens courant permettra d'accomplir ce développement de soi, ordinairement il en est plutôt le plus féroce obstacle !
« Comment peux-tu jouer au tennis toute la journée ? demanda Houei-Tseu à Tchouang-Tseu. C'est une activité qui n'a pas de sens.
– Le monde n'a pas de sens, répondit Tchouang-Tseu en s'épongeant le front.
– Oui, mais l'homme a besoin de sens, répliqua Houei-Tseu, et c'est pourquoi il fuit cette absurdité dans la pensée, par laquelle il donne sens à ce monde qui sans lui n'en aurait pas. Moi, je ne saurais vivre sans ce sens.
– Justement, mon activité est pleine de sens : par la pratique de l'absurde j'apprends à l'expérimenter, à le vivre, à l'accepter. C'est un bel et agréable exercice. Le sens de ma vie est de me faire à l'idée que la vie n'a pas de sens.
– Alors le jour où tu auras atteint ton but, tu arrêteras de jouer au tennis ?
– Au contraire, je continuerai de plus belle, mais pour le plaisir cette fois, enfin libre, comme un enfant.
– Je t'admire, Tchouang-Tseu, mais je ne t'envie pas, car l'absurde n'est pas la maison où je souhaite habiter.
– Es-tu tu sûr de ne pas aimer l'absurde ? demanda Tchouang-Tseu en clignant des yeux. L'as-tu bien regardé, l'absurde, brûler là-haut tout jaune et tout rond ? L'as-tu bien goûté, l'absurde, ferme et juteux comme la chair des pêches ? L'as-tu bien écoutée, la musique absurde ? L'as-tu bien vécu, l'absurde, ce délicieux frisson qui traverse tes membres sans raison et te laisse retomber, inerte comme un absurde caillou ? »

En automne il convient de sortir avec au front une pensée bien sombre et bien profonde. Voici donc une proposition pour demain matin, qui sera sans doute un lundi gris et glacé. Je l'écris en gros caractères pour que ça fasse plus vrai :
L'homme ne sera jamais libre
car il ne perçoit que les différences
et celles-ci, quelle que soit leur importance,
emplissent son esprit et l'occupent tout entier.
Si vous décidez de revêtir cette sombre et profonde pensée, dites à ceux qui vous le demandent qu'elle est d'un penseur chinois qu'ils ne connaissent pas ; ou alors, d'un penseur pessimiste allemand anti-leibnizien du XVIIe siècle ; ou alors, que c'est une pensée structuraliste.
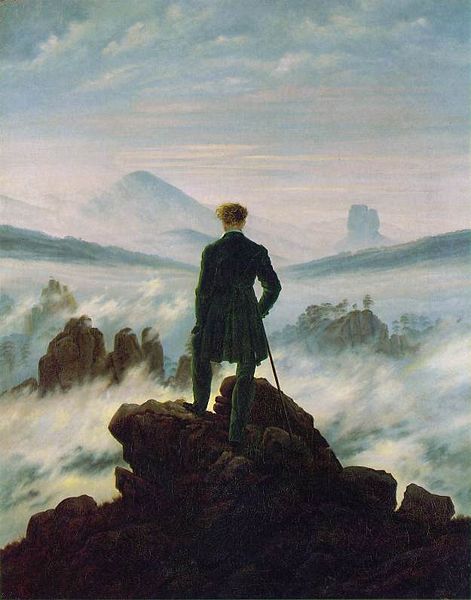
Nos humeurs sont sans raison.
On le vérifie en mille occasions. Ainsi, quand soudain, dans la rue, monte en nous une joie inextinguible et irrépressible, nous éprouvons cette absurdité avec bonheur, et notre joie redouble de son irrationalité même, sa gratuité augmente sa beauté.
Mais l'inverse est également vrai, et c'est aussi sans raison que l'on souffre, même si on cherche alors de beaux et nobles prétextes à notre chagrin.
Et dans ce cas encore, prendre conscience de cet état de fait nous rendra plus heureux, cela atténuera notre tristesse. Nietzsche avait remarqué que le sens est un remède (le grand remède) à la souffrance. Mais l'absurde en est un aussi, et plus dionysiaque que l'autre.
La fête des morts mexicaine permet d'éprouver, de ressentir dans sa chair, la vérité philosophique suivante :
La mort rend joyeux.
C'est ainsi qu'en sortant de l'exposition sur les vanités (tableaux illustrant, par des images morbides, la misère de la condition humaine) qui se tenait au musée Maillol à Paris, de nombreux visiteurs étaient étonnamment gais.

Fête des morts au Mexique
Mais il n'y a là rien d'étonnant. L'idée de la mort attriste, certes, mais elle donne aussi le sentiment de la brièveté de la vie. D'où la soudaine envie de faire n'importe quoi, et vite. C'est ainsi que la joie se distingue du bonheur : la joie est une envie de vivre où entre un peu de folie, d'hystérie, d'angoisse, de frénésie.
Et aussi beaucoup d'allégresse, car la mort suscite le sentiment de l'absurde, qui nous soulage en allégeant nos misères quotidiennes : il nous rappelle qu'elles n'ont pas de sens.
On retrouve cette idée d'une joie qui naît de l'angoisse un peu partout, par exemple chez Heidegger, ou dans cette chanson de Brel :
J'veux qu'on rie,
j'veux qu'on danse,
j'veux qu'on s'amuse comme des fous
J'veux qu'on rie,
j'veux qu'on danse,
quand c'est qu'on m'mettra dans l'trou
On comprend, maintenant, pourquoi les squelettes ont le sourire...

Et surtout on comprend pourquoi il n'y a plus de joie de nos jours. (Raoul Vaneigem, je crois, remarque qu'il n'existe plus de musique joyeuse depuis le Moyen Age.) C'est parce qu'aujourd'hui, on ne meurt plus. La mort est obnubilée, exclue de notre champ de vision.
L’homme souffre sans raison. Son spleen est biologique, hormonal, physiologique, cérébral, chimique. Il est cocasse de voir l’homme, trois fois détrôné, faire preuve d’un ultime orgueil et refuser d’admettre cette si simple vérité pour chercher à justifier sa mélancolie chronique par de grandes raisons métaphysiques, sonnantes et trébuchantes, comme un enfant qui, ayant oublié pourquoi il pleure, se cherche de grands et naïfs prétextes pour ne pas avoir l’air ridicule et éventuellement décrocher un petit câlin.

Je reviens sur un problème philosophique classique, mais qui me semble vraiment absolument fondamental. Je veux parler de la distinction entre la méthode et le système, c'est-à-dire entre le chemin et le point d'arrivée (d'ailleurs étymologiquement méthode signifie chemin, en grec). D'un côté donc, le processus, l'action, le désir en activité ; de l'autre quelque chose de fixe, figé, l'idéal, le bonheur, le but, la fin, le terme.
Ces deux concepts donnent lieu à une contradiction fondamentale si on oublie l'un ou l'autre :
Bien sûr, il faut raffiner l'analyse, nuancer, distinguer. Mais pour prendre un cas empirique simple, on verra apparaître cette contradiction entre les philosophes qui s'attachent plutôt à poser des questions qu'à y répondre (approche de la méthode) et ceux qui considèrent que le but reste de répondre, sans quoi la question n'a pas de sens (approche du résultat).
Le chercheur est fortement pris dans la contradiction, car si son but est de trouver, son existence en tant que chercheur est provisoire et inutile. En tant que chercheur, il doit disparaître. Et si son but n'est pas de trouver, à moins qu'il soit philosophe il aura bien du mal à obtenir des crédits, donc à exister. Et plus profondément, il aura du mal à donner un sens à sa quête : que signifie une recherche qui d'avance se prend elle-même pour fin et n'espère aucun résultat, au contraire (car la découverte d'un résultat signifierait la fin de cette activité que l'on aime tant) ?
On retrouve donc dans le cas du chercheur (ou du philosophe) la structure kamikaze du désir : le désir est une tension qui vise à se résorber, donc à s'auto-détruire. Profond paradoxe de la vie. ![]()
Dans la vie quotidienne, en revanche, la contradiction peut être résolue facilement, pourvu que l'on distingue d'un côté des activités productrices (typiquement : le travail), qui visent un résultat, et dont on souhaite clairement la disparition, ou la minimisation, et d'un autre côté des activités libres, faites pour elles-mêmes, pour le plaisir : loisir, jeu, activités sportives et intellectuelles, amour et relations humaines, etc. Je n'invente rien, on retrouve ici la vieille distinction d'Aristote entre poiesis et praxis.
Ce que montre cette analyse, c'est que cette distinction était nécessaire pour que la vie ne s'effondre pas dans une gigantesque contradiction !
Concrètement, existentiellement, on peut ressentir la contradiction si l'on centre sa vie sur une activité qui vise certains résultats, ce qui est le cas de nos chercheurs évoqués plus haut.
Conclusion paradoxale :
Vouer sa vie à un but,
c'est la priver de sens !
A moins bien sûr d'assumer sa position de kamikaze. Mais on risque fort d'y laisser la peau, que l'on parvienne ou non au but désiré !
Toute cette analyse présuppose une approche individualiste, et la contradiction se dissipe si on admet qu'une vie peut trouver son sens ailleurs qu'en elle-même. Selon cette solution discutable, la vie d'un esclave et d'un bienfaiteur de l'humanité sont pleines de sens.
Ô joie ! ![]()
Euh... excusez-moi. Parfois on déborde de joie, c'est tout, c'est comme ça. Et on peine à la contenir. Ô moments bénis et sauvages ! Il y a de ces extases ! Et comme une traînée de poudre tout s'enflamme et explose en série...
Mais ce dont je veux parler aujourd'hui n'est pas spécialement joyeux. Il s'agit d'un drôle de phénomène : chialer au cinéma. Car au cinéma on ne pleure pas : on chiale. Comme un débile.
Quand j'étais gosse, c'est-à-dire jusqu'à il y a peu, je ne chialais pas au cinéma. Non non. Je me blindais, et nada. Défense psychologique, bouclier mental. Je ne sais pas comment je faisais. Il me semble que je me disais « ce n'est qu'un film ». Je ne voulais pas rentrer dans cette sentimentalité, je trouvais ça gluant. Puis peu à peu je me suis fait avoir par le roman : dans Victor Hugo, il y a de ces scènes morales qui font monter les larmes aux yeux. Par exemple celle-ci, qui est une histoire vraie :
Mon père, ce héros au sourire si doux,
Suivi d'un seul housard qu'il aimait entre tous
Pour sa grande bravoure et pour sa haute taille,
Parcourait à cheval, le soir d'une bataille,
Le champ couvert de morts sur qui tombait la nuit.
Il lui sembla dans l'ombre entendre un faible bruit.
C'était un Espagnol de l'armée en déroute
Qui se traînait sanglant sur le bord de la route,
Râlant, brisé, livide, et mort plus qu'à moitié.
Et qui disait : « A boire! à boire par pitié ! »
Mon père, ému, tendit à son housard fidèle
Une gourde de rhum qui pendait à sa selle,
Et dit: « Tiens, donne à boire à ce pauvre blessé. »
Tout à coup, au moment où le housard baissé
Se penchait vers lui, l'homme, une espèce de maure,
Saisit un pistolet qu'il étreignait encore,
Et vise au front mon père en criant : « Caramba ! »
Le coup passa si près que le chapeau tomba
Et que le cheval fit un écart en arrière.
« Donne-lui tout de même à boire », dit mon père.
Et peu à peu je me suis mis à chialer au cinéma.
Et pourtant je n'aime pas trop ça. Je trouve toujours ça un peu gluant. Cette sentimentalité facile par laquelle le réalisateur essaie d'avoir notre cœur.
Et puis n'y a-t-il pas toujours du mensonge là-dedans ? Je suis sincèrement désolé, mais les bons et les actes grandioses, ça n'existe qu'au cinéma ! En a-t-on jamais vu, ne serait-ce qu'une seule fois, dans la vie réelle ? Dans la vie réelle on perce aussitôt à jour l'intention mesquine, ou alors on éclate de rire (tous les grands penseurs, au premier rang desquels Victor Hugo, ont remarqué cette étonnante proximité entre le sublime et le grotesque).
Bref, c'est le genre de larme qu'on n'a pas envie de boire au moment où elle roule jusqu'à nos lèvres. Et on cache tant bien que mal notre visage dégoulinant au voisin qui nous guette du coin de l'œil.
![[Affiche du film Welcome]](http://coursphilosophie.free.fr/images/cinema/welcome.jpg)
Je dis ça mais je chiale comme un gosse maintenant. Et il suffit de pas grand-chose. Parfois un rien. Tenez : aujourd'hui, c'était le film Welcome que je regardais. C'est l'histoire d'un gosse Irakien qui veut aller en Angleterre, et il apprend à nager pour traverser la Manche à la nage car il n'a pas d'autre choix. Eh bien, rien que de voir ce gosse nager dans la piscine pour s'entraîner, ça me faisait quasiment chialer.
Alors pour défendre cette larme, on pourrait dire qu'elle révèle notre profonde sensibilité. Il y a une belle scène dans le film American Beauty, ou le jeune garçon dit à sa petite chérie, en lui montrant la vidéo qu'il a faite d'un sac plastique poussé par le vent, qu'il y a tant de beauté dans le monde, que si on est assez sensible, cela en devient intolérable... et il se met à chialer.
Cela dit, celui qui a développé sa sensibilité n'aurait pas besoin de la fiction pour pleurer, il pleurerait devant la réalité, en regardant le journal télévisé. Alors que celui-ci nous arrache, dans le meilleur des cas, une moue de dégoût ou de lassitude. Un homme qui se mettrait à pleurer face à cela serait certainement doué d'une sensibilité et d'une compassion exceptionnelles. Ça arrive peut-être au Dalaï-Lama.
D'autre part on sait ce que pense Spinoza de la compassion : c'est une tristesse, donc un sentiment désagréable et qui nous affaiblit. Il faut donc l'éviter autant que possible.
Je me demande ce que dirait Spinoza de ce curieux plaisir qu'on prend à chialer au cinéma, et qu'Aristote a appelé la catharsis, c'est-à-dire la purgation... Le purgatoire serait donc une salle de ciné ?
Je ne sais que répondre pour conclure. Mais décidément cette larme me paraît suspecte. Suspecte de nous satisfaire en nous donnant bonne conscience : « Dis-donc chérie, je croyais que je n'étais qu'un salaud sans cœur, mais je suis rassuré, je viens de chialer un bon coup au cinéma. Finalement moi aussi je dois être un bon. » Et on retourne au boulot tranquillisé. Pôm pôm pôm...
Tiens, voilà que cette larme a séché sur ma lèvre.
Croyez bien que je ne suis pas responsable de ce que je pense et écris.
Sans blague, ça parle dans ce que j'appelle moi. ![]()
Si les taoïstes ont raison, si le bien et le mal sont liés et n'existent que l'un par rapport à l'autre dans des proportions semblables, alors nous sommes face à de grandes difficultés pratiques, car il est alors illusoire d'espérer améliorer quoi que ce soit.
On peut certes continuer la bataille (de prof, d'homme politique, de scientifique, de médecin) mais sans espérer vaincre un jour (l'ignorance, l'injustice, l'inconnu, la maladie). Il peut bien y avoir des victoires locales, et des plaisirs momentanés ; mais aucun véritable progrès, aucune élévation durable de notre niveau de bonheur n'est possible. ![]()
On ne peut donc pas se battre dans l'idée de gagner la bataille, mais uniquement par plaisir de se battre, de jouer au grand jeu. Par conséquent si on agit, ce n'est pas pour améliorer la situation ; ce ne peut être que par vitalité, par simple désir d'agir, d'exister.
Autrement dit : le but de la vie ne peut pas être le bonheur conçu comme le terme de notre action. En revanche il peut être le plaisir du spectacle, du divertissement, de l'histoire. Avec le déclin de la religion la vie perd son sens, et à l'au-delà se substitue l'idée hégélienne que l'humanité « va quelque part ».
(D'ailleurs le christianisme ne parvenait à résoudre la contradiction et à justifier l'action qu'au prix d'une invention conceptuelle qui est la négation même de l'idée taoïste selon laquelle bien et mal sont indissociables : le paradis.)
Il est temps d'admettre cette vérité fondamentale et un peu scandaleuse : Nous ne vivons pas pour le bonheur, nous vivons uniquement par curiosité.
Cette idée m'amuse. ![]()
Elle est un peu nietzschéenne : Nietzsche préconisait une sagesse tragique, c'est-à-dire la capacité de jouir de ce spectacle tragique qu'est le cours du monde.
Ah, quelle frustration pour tous ceux d'entre nous qui n'auront pas la chance d'assister à la fin du monde ! ![]()
Vous allez pas me croire.
Y a des jours où on aime tellement la vie qu'on se dit que même mourir sera un plaisir car c'est encore vivre... où on aime souffrir car c'est encore une sensation...
Je vous avais prévenus !
(Il y a de l'indicible. On ne peut que le montrer. Il y a une grande différence entre lire une phrase et la vivre.)